
Dans un contexte troublé, marqué par une peur de l’avenir et une crainte de l’échec, la réussite semble parfois lointaine, souvent inaccessible.
Les intervenants de renom de l’édition 2023 du Graph ont permis d’esquisser quelques lignes directrices et un mode d’emploi de la réussite, qui ne feront pas pour autant oublier l’essentiel : chaque réussite est une pièce unique.

Pour sa septième édition européenne, le think tank Graph s’est réuni à Édimbourg, en Écosse, du 28 juin au 1er juillet 2023, afin d’explorer le paysage du système de santé écossais. Ce fut l’occasion, par le biais de conférences présentées par les acteurs du NHS Scotland et de visites des principaux hôpitaux du pays, de saisir les perspectives concrètes sur les enjeux jalonnant le système de santé écossais.
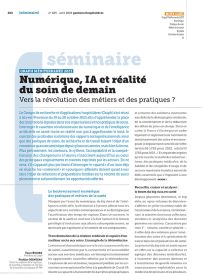
Le Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph) s’est réuni à Aix-en-Provence du 19 au 20 octobre 2023 afin d’appréhender la place des innovations digitales dans nos organisations et nos pratiques de soins. Interroger le caractère révolutionnaire du numérique et de l’intelligence artificielle en santé invite en réalité non pas à appréhender le fond, le constat des profondes mutations des rapports socioprofessionnels ainsi que des pratiques de soins, de recherche et de travail faisant l’objet d’un consensus quasi œcuménique depuis plusieurs années, mais bien la forme.

Pour sa sixième édition européenne – après Berlin (2014), Londres (2015), Stockholm (2017), Copenhague (2018) et Turin (2019) –, le Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph) s’est réuni à Oslo du 24 au 27 août 2022, avec pour objectifs d’élargir les horizons hospitaliers français, de mener une réflexion autour de modèles applicables à nos établissements et de comparer nos outils.

L’édition 2019 du Graph Alpes, qui s’est déroulée du 21 au 23 mars, avait pour thématique : «L’intelligence artificielle (IA)». Afin d’appréhender l’ensemble des enjeux, plusieurs intervenants de renom ont exploré le sujet sous différents angles – scientifique et technologique, philosophique, sociologique, artistique –, permettant ainsi d’anticiper les évolutions à venir, notamment dans le champ de la santé.

Après Berlin (2014), Londres (2015), Stockholm (2017) et Copenhague (2018)(1), la cinquième édition européenne du Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph)s’est tenue à Turin du 17 au 20 avril 2019, avec pour objectifs d’élargir les horizons hospitaliers français, de mener une réflexion autour de modèles applicables à nos établissements et de comparer nos outils.
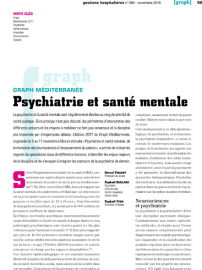
L’édition 2017 du Graph Méditerranée, organisée du 9 au 11 novembre à Nice et intitulée «Psychiatrie et santé mentale, de la révolution des neurosciences à l’empowerment du patient», a permis de croiser les regards de spécialistes issus de différents horizons, d’identifier les enjeux majeurs de la discipline et de s’essayer à imaginer les contours de la psychiatrie de demain.

Après la transparence en 2015, la vérité en 2016, le changement en 2017, l’édition 2018 du Graph Alpes, qui s’est déroulée du 22 au 24 mars, avait pour thématique : « Communiquer». Un sujet qui, somme toute, englobe les trois précédentes éditions! Pour Lucien Sfez(1), «jamais dans l’histoire du monde on n’a autant parlé de communication ».

Après Berlin en 2014, Londres en 2015 et Stockholm en 2017 (1), la quatrième édition européenne du Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph) s’est tenue à Copenhague du 6 au 9 juin 2018, avec pour objectifs d’élargir les horizons hospitaliers français, de mener une réflexion autour de modèles applicables à nos établissements et de comparer nos outils.

Après Berlin en 2014 et Londres en 2015 (1), la troisième édition européenne du Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph) s’est tenue à Stockholm du 7 au 10 juin 2017, avec pour objectifs d’élargir les horizons hospitaliers français, de mener une réflexion autour de modèles applicables à nos établissements et de comparer nos outils.

« Vertu des belles âmes» pour Jean-Jacques Rousseau, la transparence s’est propagée dans toutes les sphères: politique, sociale, économique, artistique. Réinvesti dans la cité, le peuple s’approprie le rôle central de vigile démocratique. Adossée à l’outil numérique, la transparence œuvre à une plus grande accessibilité de la connaissance.

Après Berlin en 2014, la deuxième édition européenne du Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph) s’est tenue à Londres, avec pour objectifs d’élargir les horizons hospitaliers français, de mener une réflexion autour de modèles applicables à nos établissements et de comparer nos outils.

Les échanges au sein du séminaire du Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph) Méditerranée qui s’est déroulé du 15 au 17 octobre 2015 ont permis de comprendre les enjeux de la santé connectée et d’apporter des propositions afi de faire progresser notre système de santé, en remettant médecins et directeurs d’hôpital au cœur de cette révolution.

La première édition européenne du Groupe de recherche et d’applications hospitalières (Graph) s’est tenue à Berlin avec, pour objectifs, d’élargir les horizons hospitaliers français, de mener une réflexion autour de modèles applicables à nos établissements et de comparer nos outils.

Après la transparence, après la transmission, la reconnaissance était l’objet de ce séminaire de mars 2011. Mais reconnaître sans partager n’avait pas de sens, reconnaître pour soi, reconnaître pour disposer d’un statut meilleur ou de moyens complémentaires sans l’ouverture qui est le partage conduisant à une impasse. Reconnaître, c’est demander aux autres une meilleure lecture de son action, partager c’est redonner aux mêmes ce que l’on demande.

Savoir où aller suppose que l’on donne du sens à l’action humaine et continuer son chemin, c’est bien assurer le lien entre un passé et un devenir. Comme toute organisation humaine, l’hôpital public s’adapte dans une évolution que Teilhard de Chardin désignait par le terme «orthogénèse», c’est-à-dire une évolution dirigée, ici pour l’hôpital par les valeurs de service public, c’est-àdire une forme d’humanisme qui n’indique pas le chemin à prendre mais la direction à maintenir et à retrouver.
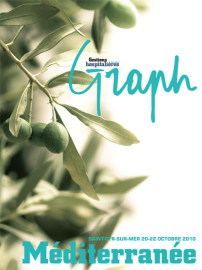
En tant qu’espace d’échanges, de comparaisons d’objets, de terrains et de méthodes, il nous a paru intéressant, dans le cadre de ce premier séminaire méditerranéen du Graph, de se pencher de part et d’autre de ces rives pour voir si elles offrent un terreau propice au développement d’un modèle de gestion interméditérranéen, alternatif, efficace et transposable.

Les Arcs sont la combinaison d’une continuité et d’un désir de prospective. Depuis plus de vingt ans, le Graph organise un séminaire résidentiel ouvert à tous ceux qui essaient, selon le mot du président Alain Halbout, de «tracer les portes du futur». Dans un système complexe en pleine restructuration, où les réformes se succèdent à la vitesse du progrès médical, il est important que l’on puisse réfléchir sur le sens de l’évolution de nos organisations dans une dimension culturelle, stratégique et opérationnelle.

Le fil rouge de notre réflexion commune est « transparence et langages », « langages » au pluriel. Nous réfléchissons souvent sur le sens et les valeurs, sur ce qui fait sens et ce qui donne sens. Dans Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll fait rencontrer Humpty Dumpty et Alice. Cette dernière utilise un mot en étant convaincue que ce qui compte est le sens universel du mot, mais son interlocuteur répond que les mots disent ce que nous voulons qu’ils disent : ils ne sont jamais neutres, il s’agit toujours d’un rapport de force.
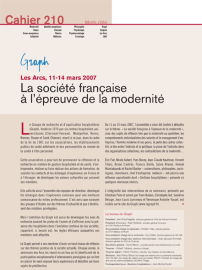
Du 11 au 14 mars 2007, l’assemblée a ainsi été invitée à débattre sur le thème: «La société française à l’épreuve de la modernité», avec des sujets de réflexion tels que la modernité au quotidien, les comportements individualistes des salariés et le management d’entreprise, l’homme moderne et ses peurs, la perte des cadres collectifs, le lien entre l’individu et la politique, la place de l’individu dans des organisations collectives, les contradictions de la modernité…

Plonger, et se sentir soi-même plongé dans l’incertitude, telle pourrait être la manière la plus appropriée pour aborder et traverser un sujet aussi terriblement incertain, par essence, que ladite incertitude. Et du coup, celle-ci se voit déjà installée avant même de pointer son nez, puisque d’emblée se pointe la question que tout orateur et tout auteur se posent, et qu’il leur faut résoudre dans l’urgence : comment commencer ?

À l’hôpital managé, tout est analysé, disséqué, évalué, jugé… Et pourtant, l’essentiel nous échappe: une réalité diffuse; suintante au long des murs, cachée dans le tréfonds des âmes et des corps meurtris. Le Graph a souhaité vous en parler, dans l’incertitude qui nous habite: «Qui apprendrait les hommes à mourir leur apprendrait à vivre.» (Montaigne)

Le thème du patient au coeur du système d'information est très intéressant dans la mesure où le patient a été placé au coeur de la réforme de notre système de soins. Les établissements publics et privés sont en confrontation directe, et le patient dans ce contexte fait l'objet de toutes les attentions. Nous sommes entrés dans un nouveau monde, celui des recettes. Lorsque les textes incitent à ce que les usagers soient davantage présents dans les conseils d'administration des établissements hospitaliers, ils nous indiquent de facto que les exigences du patient se sont étendues.
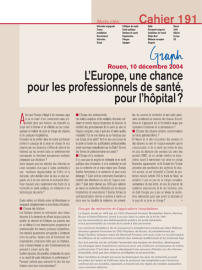
Alors que l’Europe s’élargit à dix nouveaux pays et va se munir d’une construction sans précédent dans son histoire, les objectifs du Graph sont d’informer et de réfléchir sur ses conséquences en matière de prise en charge des citoyens et de pratiques hospitalières.

Le séminaire Graph de mars 2002 a été consacré à la question de la violence et a réuni autour de ce thème Roger Dadoun, philosophe et professeur à Paris-VII, Jean Furtos, psychiatre au Vinatier, Claudine Esper, juriste, professeur à Paris-V, Alain Hamon, conseiller pour la sécurité à l’AP-HP, Jean-François Caillard, professeur chef du service central de médecine du travail de l’AP-HP, Bernard Proust, professeur de médecine légale au CHU de Rouen, et Michel Godet, professeur au Cnam.

